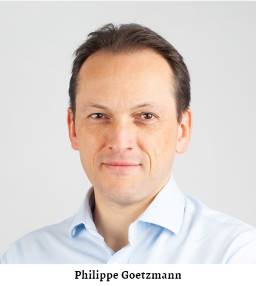L’archipel de la confiance
04/03/2022
Y a-t-il aujourd’hui plus qu’hier une crise de confiance des consommateurs ?
Philippe Goetzmann [1] : Dire cela est assez convenu aujourd’hui. Notre société est assez pessimiste et regarde avec plus d’attention ce qui va mal. S’il y a certes des signes, au fond je ne crois pas à cette crise. D’abord, la confiance dans les marques s’est plutôt redressée depuis le début de la pandémie. Le contexte amène à chercher des signes de réassurance. Et même sur le vaccin dont on ne parle que pour évoquer les « antis », observons que le taux de vaccination en France est extraordinairement élevé. C’est bien qu’une majorité fait confiance. En fait, il y a un déplacement et une fragmentation de la confiance. Auparavant, la confiance était univoque, en l’État, les institutions… en tant qu’organisations installées voire intangibles. Aujourd’hui, la confiance existe, mais en ce qui « fait » plus qu’en ce qui « est ». L’autorité tutélaire, qu’elle soit politique ou marque, n’est pas digne de confiance, mais son action peut l’être. Ce qui renvoie à la résonnance entre l’action menée et les aspirations multiples des consommateurs, et par conséquent au sujet de la fragmentation de la société.
Si défiance il y a, quels secteurs de la consommation y sont les plus exposés : grande conso alimentaire, grande conso non alimentaire, banque, assurance, services, santé, transports… ? La fréquence d’achat est-elle un facteur constituant un « biais d’exposition » à la défiance pour la grande consommation ?
P. G. : Il est certain qu’on a plus confiance en ce qu’on fréquente, ce qui peut avantager la grande consommation. Mais ce n’est pas une vérité générale. On a peu confiance en les garagistes, mais le sien est toujours très bien. C’est l’intensité de la relation qui prime. Vous pouvez avoir des relations espacées, mais si elles sont fructueuses, elles inspirent confiance. On n’achète pas un iPhone chaque matin et pourtant la marque et la qualité de service d’un Apple Store inspirent confiance. Cela étant, la question de la confiance se pose aussi relativement au niveau de risque perçu, aux enjeux vécus, à notre sensibilité. Le besoin de confiance est très élevé envers notre banquier, nos moyens de paiement. Mais aussi envers ce qu’on ingère. Tout ce qui touche notre intégrité et notre intimité. Aujourd’hui les préoccupations environnementales posent aussi la question aux entreprises dont l’impact est nettement perçu.
Impossible personnalisation des preuves
La confiance dans les produits et les marques, et dans les fabricants, se fonde sur des preuves ; viendraient-elles aujourd’hui à manquer ?
P. G. : Oui, forcément, mais c’est plus subtil que cela. Face à un marché massifié, aux aspirations convergentes, les marques ont créé la confiance sur une promesse intrinsèque au produit lui-même. En alimentaire, le goût, le plaisir. En droguerie, l’efficacité des produits. La confiance en l’efficacité d’une lessive était de savoir si elle lavait bien. Et si elle lavait approximativement, la confiance baissait mais ce n’était pas bien grave.
Aujourd’hui, les aspirations des consommateurs sont multiples, en ce sens qu’il y a une multiplicité de consommateurs. Or une marque ne peut personnaliser ses preuves en fonction de l’individu. Outre qu’industriellement c’est compliqué, la preuve fait la marque. À multiplier les preuves on dilue la marque dans une cacophonie de discours. Alors que la confiance des consommateurs exige d’approfondir le discours et les preuves, tout approfondissement éloigne les consommateurs pour qui ces valeurs sont marginales.
Cette situation est terrifiante pour les marques, dans un monde fragmenté. Plus elles développent la confiance de leur cœur de cible, plus elles verront leur territoire se réduire. Il n’y a pourtant pas d’autre option. Nous allons probablement vers plus de marques, plus étroites, plus segmentantes. Des marques que j’appelle combattantes.
Depuis 1950, le risque alimentaire létal a été divisé par cent, mais dans le même temps les allergies alimentaires se sont développées. Faut-il croire, comme 46 % des Français [2] que « l’alimentation, c’était mieux avant » ?
P. G. : Certainement pas. Je fais un parallèle : vivait-on mieux quand il y avait moins d’Alzheimer parce que l’espérance de vie ne permettait pas de connaître ce risque ? Nous n’avons jamais aussi bien mangé, tout le démontre. Tant en qualité qu’en diversité de produits accessibles. Regardez le régime alimentaire d’une famille il y a soixante ans ! Mais il est vrai que les changements qui ont permis cette formidable évolution ont aussi eu des effets négatifs. L’allongement des chaînes logistiques (qui a permis la diversité) a développé l’usage des conservateurs, par exemple.
Aujourd’hui nous pouvons traiter ces effets de bord et améliorer l’alimentation. L’évolution des techniques culturales et industrielles permet de se passer des produits qui ont permis les avancées du XXe siècle et qui sont aujourd’hui questionnés. Tant mieux. Mais je suis sûr que ces nouvelles évolutions auront des effets de bord que nous diagnostiquerons dans dix ou vingt ans. Et que nous corrigerons alors. Cela s’appelle le progrès.
Des labels qui se font marques
La marque, créée au début du XIXe siècle comme signe de confiance du fabricant, inscrivant son nom sur l’emballage, joue-t-elle encore un rôle en termes de confiance ?
P. G. : Heureusement oui. Mais son contenu a changé, comme je viens de l’expliquer. Elle ne suffit plus à susciter la confiance dans les qualités du produit, mais elle doit véhiculer une série de valeurs connexes. Ce que je trouve intéressant, c’est que le concept de marque, qui était lié au produit et in fine à l’entreprise, au métier, se déplace. La marque, en ce qu’elle porte une promesse, des valeurs, un imaginaire, se fait collective, territoriale, servicielle, etc. Un système de notation devient marque aussi : personne n’avait jamais pensé les étoiles des hôtels comme une marque, mais Yuka, oui. On voit bien que la marque quitte le territoire du produit, produit qui n’en est qu’un élément. La marque se réinvente.
Il est des recettes qu’un industriel doit tenir secrètes sous peine de perdre sa singularité ; est-ce qu’en pratique cela représente une restriction à la transparence utile à la confiance ?
P. G. : La transparence n’est pas l’exhibition. Ne pas montrer les secrets d’une démarche sincère, engagée, incarnée, est très différent de cacher des pratiques contestables.
Les labels sont-ils en grande consommation des vecteurs de confiance aussi ou plus ou moins importants que les marques ?
P. G. : Ils auraient pu le devenir. Mais par leur profusion excessive, leur complexité, leur vacuité souvent, leur manque de diffusion et de notoriété, ils peinent à prendre le pas sur les marques. Même le bio commence à connaître des difficultés, au point que les acteurs de « la » bio veulent un label bio « augmenté ». En fait ils sont devenus des marques, avec un cahier des charges, parfois faible, mais sans moyen marketing ni gouvernance claire. Il y a néanmoins des exceptions.
Algorithmes et sources contestables
Et les applications de notation [3] ?
P. G. : Le système de notation peut en effet en venir à suppléer la marque. Puisqu’il substitue la mesure à la promesse. C’est un vrai défi. Encore faut-il que la note soit incontestable. Or il n’y a pas de consensus scientifique sur ces notes, qu’il s’agisse du NutriScore pour la nutrition, des Éco ou PlanetScore pour l’environnement, ou bien sûr de Yuka et tant d’autres. Le problème est double. Aucun de ces algorithmes n’est incontestable. Certains sont même parfois franchement orientés. Ils sont construits en fonction de la vision de leurs promoteurs et non du métabolisme personnel du consommateur ou de ses aspirations sociétales.
Chaque individu étant singulier, nous devrions plutôt aller vers une évaluation individuelle. Ensuite, ces systèmes rencontrent un véritable problème d’accès à la donnée. Pas seulement la donnée du produit, mais celle de sa production. Je ne crains pas de dire que tout système de notation qui serait fait sans et hors les entreprises serait faux et parfois dangereux (pour les consommateurs, la planète…). Cela n’est pas pour rejeter ces notes, mais pour appeler les marques à se saisir du sujet et le traiter. Un système de notation juste est celui qui bénéficie de la juste donnée. Les marques doivent se mobiliser sur la fiabilisation de la donnée et se coaliser pour la gouverner.
Prenons garde au prêt-à-penser de la notation qu’on nous propose aujourd’hui. Les avis de Google sur Baudelaire ou de Télérama sur les meilleurs films de l’histoire doivent-ils nous exonérer de notre propre jugement ? La note peut orienter, mais nous devons la comprendre. Et donc comprendre les produits que l’on achète. Sans cet effort de compréhension, et donc de pédagogie, la note est une aliénation.
Les systèmes de notation orientent-ils toujours la R&D vers des produits plus sains, plus écoconçus, etc., ou peuvent-ils exercer un effet parfois moins désirable ?
P. G. : Hélas non. Dans un système idéal, la note devrait évaluer positivement ceux qui font mieux. Or on observe que la R&D, et c’est normal, n’essaie plus de faire mieux mais d’avoir une meilleure note, c’est-à-dire de plaire à celui qui fait la note. C’est vrai des restaurants qui courent à l’étoile, comme de ceux qui triturent les recettes dans un sens qu’ils savent discutable, parce que tel notation célèbre sera meilleure. Une note aussi a ses effets pervers.
Les « applis conso » risquent-elles de créer une fracture entre ceux qui comprennent et peuvent suivre les recommandations, et d’autres qui consomment (parfois des produits ultra-transformés) sous contrainte de pouvoir d’achat et de distance ?
P. G. : Question intéressante. Je la retourne. Elle pourrait surtout créer une fracture entre ceux qui comprennent ce qu’ils consomment, se connaissent et n’ont donc pas besoin d’appli, et ceux qui par paresse ou ignorance s’en remettent à d’autres de ce qu’ils consomment. C’est pourquoi il faut une vraie éducation alimentaire, sans doute dès l’école. Mais c’est aussi une responsabilité des entreprises que d’aider à une bonne consommation, par la pédagogie des étiquettes, la communication et le conseil en magasin.