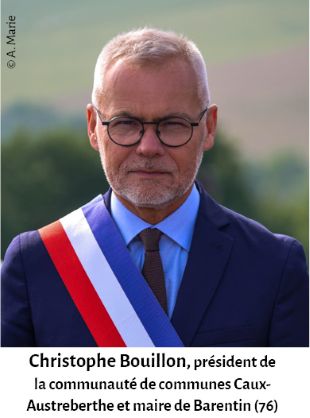Entreprises et territoires
Des marques à l’appui d’une marque territoriale
26/09/2025
Qu’attendez-vous de l’implantation d’entreprises sur votre territoire ?
Christophe Bouillon : Je me limiterai à trois apports majeurs : l’emploi, les ressources et l’image. L’emploi est naturellement notre préoccupation essentielle : toute collectivité a besoin que ses habitants puissent trouver un travail localement. Les ressources comptent aussi, car elles alimentent le budget de la collectivité et permettent de financer infrastructures, transports, équipements culturels ou sportifs. Enfin, l’image s’impose également de plus en plus : accueillir une entreprise reconnue, c’est donner à son territoire une visibilité nationale, parfois même internationale. Certaines entreprises disposent de marques fortes. En s’implantant, elles nous aident à forger une véritable marque territoriale. Elles inscrivent le territoire dans un récit collectif et lui évitent de risquer de disparaître. Dans un monde où beaucoup de régions se sentent comme sorties de l’histoire, c’est un atout considérable.
Cette dimension d’image est-elle importante pour vos concitoyens ?
C. B. : Absolument. Historiquement, bon nombre de salariés s’identifiaient à leur entreprise : on disait « Je suis Moulinex », « Je suis Ferrero ». Cela créait une identité forte, parfois transmise sur plusieurs générations. Les bassins industriels étaient structurés par ces grandes usines, les habitants partageaient une fierté commune. Aujourd’hui, l’ancrage d’une grande marque est vécu comme la preuve que le territoire a toujours sa place dans le récit national, surtout dans ce moment de réindustrialisation que nous traversons. De plus, quand une marque communique par la publicité, son image positive rejaillit sur le territoire où elle est implantée. Ses habitants s’y reconnaissent.
Quelles collaborations développez-vous avec les entreprises locales ?
C. B. : Notre territoire possède une zone commerciale régionale majeure, mais aussi des PME et ETI industrielles dans divers secteurs : agroalimentaire, automobile, bâtiment… Nous avons déjà vécu des mutations : autrefois très actifs dans le textile, nous avons dû nous réinventer dans les années soixante-dix. Aujourd’hui, nous avons adopté une méthode qui se concentre sur le partage de toutes les transitions : numérique, écologique, démographique, démocratique. Tout cela participe à nos échanges avec les entreprises. En 2020, nous avons élaboré un projet de territoire, sorte de carte d’identité partagée. Nous avons organisé des ateliers où les entreprises ont exprimé leur vision et leurs besoins. Puis nous avons poussé plus loin cette réflexion : comment abordent-elles l’IA, l’attractivité des talents, la transition énergétique ? Certaines nous conseillent dans notre communication territoriale. Nous travaillons ensemble sur le chauffage urbain, la valorisation de la chaleur fatale, la reconversion de friches industrielles, la gouvernance partagée. Bref, nous avançons côte à côte.
Atouts locaux et freins qui viennent d’en haut
Que proposez-vous aux entreprises pour les attirer ou les fidéliser ?
C. B. : Nous avons attaché à ce projet un schéma de développement économique complété de pistes d’action. Nous avons recruté un directeur de développement économique, créé des groupes de travail thématiques et organisé des réunions régulières : sur les énergies renouvelables, sur l’IA, sur la formation… Nous mettons en commun nos carnets d’adresses, nos opportunités. Lorsque nous avons du foncier disponible, nous le proposons aux entreprises susceptibles d’être intéressées. Nous avons travaillé ainsi avec Ferrero. Mais nous allons plus loin : nous réfléchissons au type d’activités nous souhaitons accueillir. Nous prenons en compte les bes oins exprimés par les entreprises pour attirer les talents : le logement bien sûr, mais aussi un cadre de vie agréable, l’accès à la culture ou des infrastructures pratiques. Nous participons aussi à des salons, comme le Mipim (Marché international des professionnels de l’immobilier) à Cannes, démarche inhabituelle pour une collectivité de 26 000 habitants seulement. Enfin, nous travaillons avec la métropole de Rouen, avec la Région, la CCI, la Chambre des métiers. Notre conviction est que seuls, nous ne pouvons pas tout, mais qu’ensemble, nous profitons d’une force de frappe.
oins exprimés par les entreprises pour attirer les talents : le logement bien sûr, mais aussi un cadre de vie agréable, l’accès à la culture ou des infrastructures pratiques. Nous participons aussi à des salons, comme le Mipim (Marché international des professionnels de l’immobilier) à Cannes, démarche inhabituelle pour une collectivité de 26 000 habitants seulement. Enfin, nous travaillons avec la métropole de Rouen, avec la Région, la CCI, la Chambre des métiers. Notre conviction est que seuls, nous ne pouvons pas tout, mais qu’ensemble, nous profitons d’une force de frappe.
Rouen est donc un partenaire incontournable ?
C. B. : Oui. Nous sommes situés à une quinzaine de minutes de la métropole par train ou autoroute. Certaines entreprises veulent la proximité directe de la métropole, d’autres préfèrent la périphérie pour des raisons logistiques. Travailler ensemble est une évidence. Nous avons choisi la complémentarité plutôt que la compétition.
Comment agissez-vous pour attirer des talents ?
C. B. : Nous avons des atouts. Notre territoire conjugue industrie et ruralité. Nous valorisons l’agriculture avec un « Projet alimentaire territorial »¹, développons l’agrotourisme, les énergies renouvelables. Nous possédons deux lycées, deux collèges, dix écoles, un théâtre. Car nous sommes bien conscients que l’attractivité économique dépend beaucoup du cadre de vie : logement, santé, transports… Nous avons créé un pôle de santé qui évite le désert médical et nous assure vingt années de sécurité démographique. Nous disposons de deux gares qui nous relient à Rouen en seize minutes, un réseau de transport en commun, un dispositif de covoiturage. Avec la métropole, nous avons signé une entente territoriale sur les mobilités, outil rare mais très pragmatique : pas de nouvelle structure, juste une feuille de route partagée. Cela répond aux attentes des entreprises, qui savent que leurs salariés vivent et se déplacent au-delà des frontières communales.
Quels freins rencontrez-vous malgré tout ?
C. B. : Le principal obstacle reste la lenteur des procédures. Le temps économique est rapide alors que le temps administratif est long. Les entreprises décident vite, mais les autorisations d’urbanisme prennent des mois, parfois des années, à être signées. Nous essayons d’anticiper en travaillant en amont avec les services de l’État, mais il y a souvent des divergences d’interprétation. Exemple concret : pour reconvertir une friche en parc, nous avons dû attendre un an à cause de la norme « quatre saisons » imposée par les études environnementales. Nous demandons plus d’agilité, comme pour les Jeux olympiques ou la reconstruction de Notre-Dame, où des procédures accélérées ont permis d’avancer sans sacrifier la concertation. Il faut sécuriser les délais et harmoniser les services de l’État.
Les contraintes environnementales suscitent-elles, comme certains les en accusent, des blocages supplémentaires ?
C. B. : Je suis favorable à la transition écologique, mais l’excès de règles pose problème. Les contentieux abusifs bloquent des projets utiles. Quand l’aménagement d’une friche abandonnée redevenue refuge pour chauves-souris impose de construire un hôtel pour elles à 300 000 euros, on atteint l’absurde. La nature reprend toujours ses droits, mais il faut raisonner en fonction du rapport coût-bénéfices, qu’il s’agisse d’éviter, de réduire ou de compenser. Sinon, nous serons incapables de reconvertir des friches, alors que c’est crucial pour l’économie et le logement. Le contentieux permanent ne concerne pas seulement l’économie : tout projet local, même un petit équipement collectif, peut être contesté. Nous devons instaurer une culture de dialogue, pas de blocage.
Une usine au cœur de la ville
Comment décririez-vous votre partenariat avec Ferrero ?
C. B. : Ferrero est, avec Carrefour, l’un des deux grands employeurs de notre communauté de communes. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’est pas un acteur dominant mais discret et ancré. Il participe au récit territorial. Le dialogue est constant et réciproque. Les équipes de Ferrero nous sollicitent sur le covoiturage ou la petite enfance ; nous les associons à nos projets de chauffage urbain. L’usine, implantée depuis plus de soixante ans, est au cœur de la ville : les habitants l’appellent « la chocolaterie ». Ferrero soutient aussi des initiatives locales, mais en cohérence avec sa politique : sport collectif, inclusion, sport et santé. Par exemple son partenariat avec le club de hockey local, qui permet l’initiation de plus de mille élèves, ou des actions sur le handicap avec une ambassadrice paralympique, la championne de boccia Aurélie Aubert. Dans tous ces cas, nous cherchons à nouer un partenariat équilibré, respectueux, où chacun apprend de l’autre.
 Le fait que Ferrero ne soit pas un groupe français ou soit parfois critiqué pour ses recettes n’est-il pas parfois une difficulté ?
Le fait que Ferrero ne soit pas un groupe français ou soit parfois critiqué pour ses recettes n’est-il pas parfois une difficulté ?
C. B. : Non. Ses investissements de plusieurs dizaines de millions d’euros sont accueillis positivement : ils prouvent que le territoire n’est pas oublié. Les habitants sont fiers d’apparaître dans la liste des investissements internationaux en France. Bien sûr, des polémiques existent sur Nutella ou l’huile de palme, mais Ferrero adopte une démarche transparente, explique ses engagements, nous informe, sans chercher à minimiser ces questions. Les habitants préfèrent qu’on leur dise tout. Les critiques viennent surtout de l’extérieur, comme lors du naming occasionné par le Kindarena², le palais des sports de Rouen. Sur le plan nutritionnel, dans une région agricole, nous savons conjuguer plaisir et prévention : beurre, sucre et betterave font partie de notre culture, mais nous insistons sur le « bien manger » et le « bien bouger ».
Comment mesurez-vous les résultats de vos collaborations et quels sont vos objectifs pour l’avenir ?
C. B. : Notre ambition provient de la certitude qu’il n’y peut y avoir d’entreprises prospères dans un territoire en déclin, pas plus que l’inverse. Nous voulons des entreprises qui aillent bien dans un territoire qui se porte bien. Cela suppose de réussir toutes les transitions et de nous maintenir dans le récit national. Nos priorités sont claires : développer les énergies renouvelables, notamment le solaire et le chauffage urbain ; reconvertir les friches en zones économiques, en parcs naturels, en équipements publics ou en logements. Montrer qu’on peut donner une seconde vie au foncier est essentiel. Le siège de la communauté de communes, installé dans une ancienne entreprise partagée avec d’autres acteurs, symbolise cette démarche. Ainsi, nous sommes en train de construire une marque territoriale forte, nourrie des marques implantées localement.
La relation entreprise-collectivités vue par Ferrero
Entretien avec Fausto Rotelli, directeur de la RSE et des relations externes de Ferrero en France.
Quelles sont vos principales attentes vis-à-vis des collectivités territoriales où Ferrero est implantée ?
Fausto Rotelli : Outre un dialogue constructif et permanent, comme celui que nous entretenons avec Christophe Bouillon et la communauté de communes Caux-Austreberthe depuis plus de soixante ans, nous attendons un accompagnement dans nos projets de développement. Lorsque nous investissons massivement – comme les 95 millions d’euros annoncés récemment pour moderniser notre site de Villers-Écalles et créer de nouveaux entrepôts à Barentin et Cléon –, nous avons besoin de collectivités qui comprennent les enjeux économiques et facilitent, autant que possible, la réalisation de ces projets structurants. Et nous cherchons des partenariats sur l’attractivité territoriale. Nos mille salariés normands et leurs familles doivent pouvoir bénéficier d’un cadre de vie de qualité : transports, santé, éducation, culture...
Avez-vous déjà mis en place de tels partenariats ?
F. R. : Absolument. Ferrero entretient des partenariats multiples et divers, en particulier avec les collectivités normandes. Notre contribution au territoire participe aussi à son développement économique et à son attractivité. Nous avons deux cas éloquents. Avec la métropole Rouen Normandie, nous avons un accord de naming du Palais des sports, baptisé Kindarena. Ce partenariat, qui représente plusieurs millions d’euros d’investissement, va bien au-delà de la simple visibilité : il contribue au développement sportif et culturel de la métropole. Avec la communauté de communes Caux-Austreberthe, nous travaillons sur des projets de transport, notamment une ligne de bus reliant la gare à notre usine. Le projet de reconversion de la friche Badin³ illustre notre approche : nous participons activement à la transformation de cette ancienne zone industrielle en espace mixte alliant activités culturelles, économiques, sportives et espaces verts.
Quelles difficultés rencontrent de tels partenariats ?
F. R. : Le principal défi que nous partageons avec les collectivités, ce sont les procédures administratives. Comme le souligne Christophe Bouillon, le temps économique est rapide, alors que le temps administratif est plus long. Quand nous décidons d’investir 95 millions d’euros pour moderniser nos installations, nous avons besoin, pour les autorisations d’urbanisme, de délais prévisibles et maîtrisés – sur ce point, je dois noter l’excellente collaboration avec la préfecture et les services déconcentrés sur le territoire. J’ajouterai le volet des aides publiques : nous constatons parfois des divergences d’interprétation entre les différentes directions centrales de l’État.
Quels projets souhaitez-vous développer à l’avenir avec les collectivités ?
F. R. : L’avenir de nos partenariats avec les communautés urbaines environnantes concerne notamment la transition écologique et énergétique. Nos investissements actuels incluent d’importantes améliorations énergétiques, que nous aimerions connecter aux projets territoriaux de développement durable. Nous aimerions aussi travailler avec les collectivités à des projets de logement pour nos salariés, à l’amélioration des transports – notamment pour renforcer les liaisons ferroviaires avec Rouen – et au développement de l’offre culturelle et sportive.